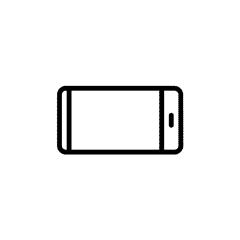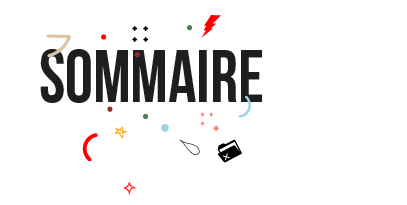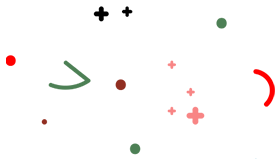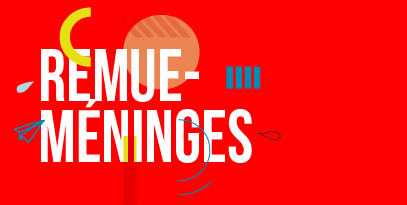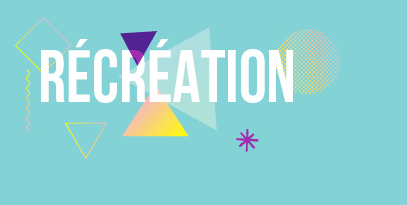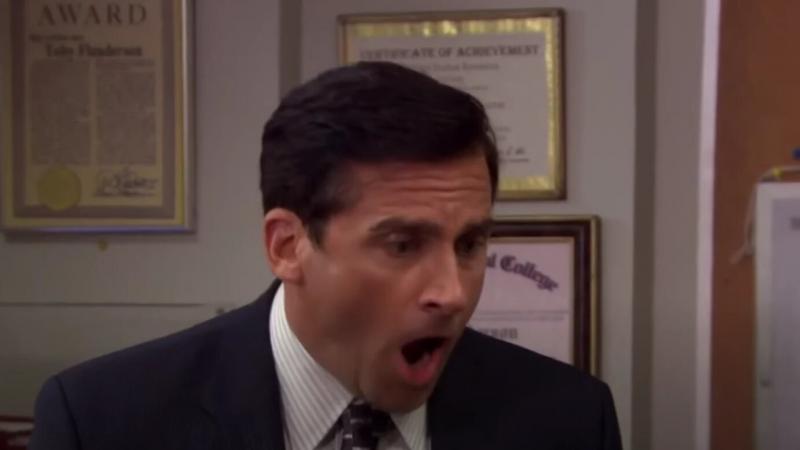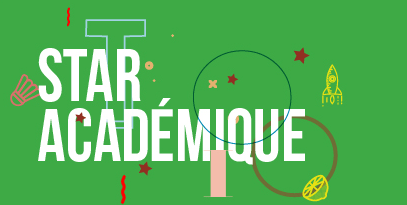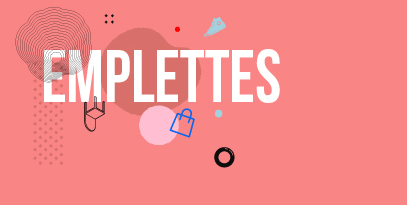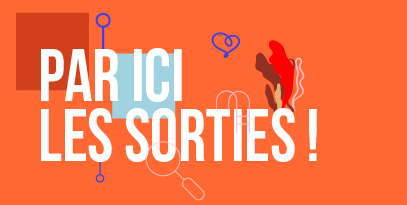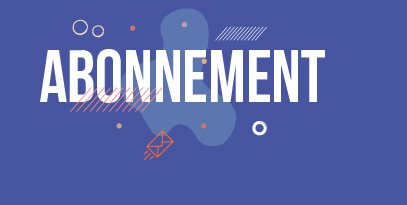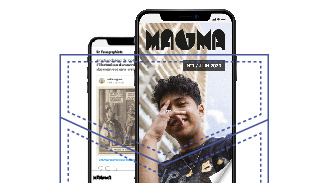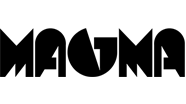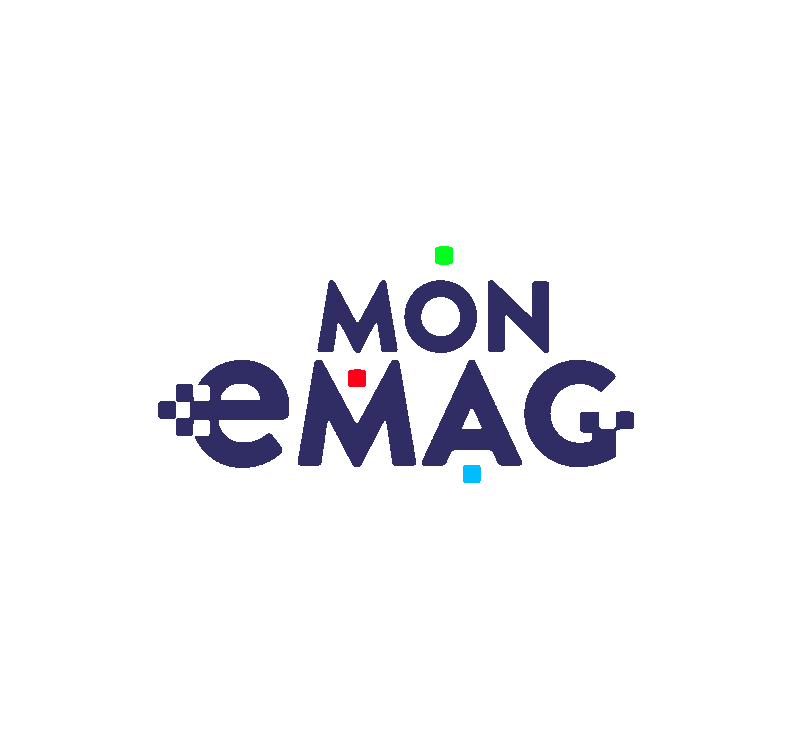La méritocratie, vaste fumisterie ?
Le terme « méritocratie », qui signifie étymologiquement « gouvernement par le mérite », a été utilisé pour la première fois en 1958 par Michael Young (rien à voir avec Fatal Bazooka), dans son livre The Rise of the Meritocracy. Dans cette fiction de sociologie, il dénonce la manière dont le système éducatif anglais, qui place le diplôme au-dessus de tout, accentue les inégalités et imagine une société totalement dénuée de lien social. Young prévoyait aussi le soulèvement populaire pour 2033 : patience.
Inégaux dès le berceau
Dans le champ de l'éducation, la méritocratie est particulièrement palpable. Elle se traduit notamment par le système des concours, a priori égalitaire : ils reposent sur les savoirs et sont ouverts à tous. Dans un monde merveilleux, seuls les plus intelligents, les plus doués, les plus motivés accèderaient ainsi aux grandes écoles et aux fonctions à responsabilité. Sauf qu'on sait très bien que dans la réalité, ceux qui réussissent sont majoritairement et largement avantagés par leur capital économique, social et culturel (coucou Bourdieu). Ainsi, 73% des élèves des grandes écoles proviennent d'un milieu très favorisé ou favorisé, selon une étude (intéressante et désespérante) de l'institut des Politiques Publiques parue en 2021. Et il n'y a absolument rien d'étonnant là-dedans, quand on sait que le futur niveau d'étude d'un enfant peut être estimé au nombre de livres présents dans un foyer.
« S’en donner les moyens »
Celui qui a du mérite est celui qui, à partir d'un talent donné, s'est donné « les moyens » de réussir. Les moyens, ce sont l'application, la volonté, la détermination, mais ce sont aussi les moyens financiers (investir dans un équipement, dans un cours particulier ou simplement avoir le luxe du temps libre pour s'exercer). Au-delà des considérations matérielles et du caractère aléatoire du talent (tout le monde n'a pas « un don ») toutes les capacités ne se valent pas.
Prenons l'exemple du joueur de football professionnel : souvent issu d'un milieu populaire, à partir d'un « don » et avec beaucoup de travail et d'entraînement, il parvient à un niveau de rémunération qui donne le vertige. Vous avez déjà entendu parler d'un virtuose du triangle devenu millionnaire ? Bah non. Le talent, pour alimenter le moulin de la méritocratie, doit se situer dans un secteur juteux. Cette même constatation s'applique à ceux qui « ont du mérite », et qui se sont retrouvés sous le feu des projecteurs avec la pandémie : le personnel soignant et autres « travailleurs essentiels », qui ont tous en commun de gagner des clopinettes. Comme quoi, le mérite ne paye pas forcément.
Alors les feignasses ?
Si la méritocratie est critiquée à longueur d'essais (Chantal Jaquet, Elise Tenret, François de Closets, Jules Naudet, Thomas Piketty, Michel et Monique Pinçon-Charlot, Michael Sandel, pour name dropper un peu), c'est parce qu'elle est vicieuse. En donnant l'impression que la réussite est une question de volonté, non seulement elle efface les inégalités, mais elle justifie l'ordre établi tout en culpabilisant ceux qui échouent. En gros, si vous êtes nul, vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même, et ce n'est pas à la société ou à l'État d'agir pour vous sortir du caca. Et pour alimenter le mythe de la méritocratie, on objecte à chaque critique les cas rarissimes de ceux qui ont réussi malgré tous les obstacles : des exceptions qui semblent faire règle. Si le mythe de la méritocratie est si tenace, c'est parce qu'il est socialement valorisé, mais aussi parce qu'il est nécessaire. Si on se dit que notre destin est scellé et que nous sommes condamnés à rester enfermé notre condition, à quoi donc rêver ? Pourtant, il n'y a pas vraiment matière à fantasmer, puisque les inégalités s'intensifient. Ainsi, ces quarante dernières années, les revenus des 10% les plus riches ont augmenté de 121%, tandis que le revenu de la moitié inférieure de la population n'a enregistré aucune progression, comme le souligne Thomas Piketty dans L'économie des inégalités. Vivement 2033 !
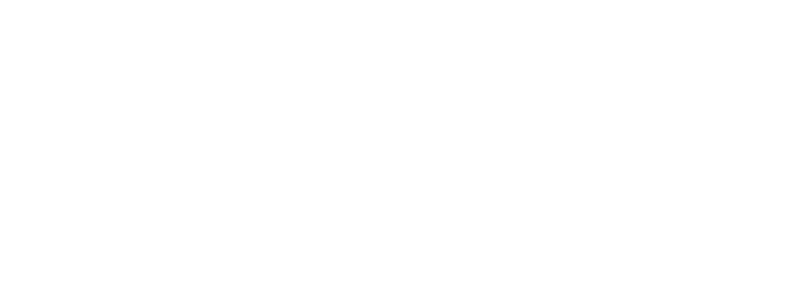
À suivre ...
 Chiffres /Inégalités des richesses : l’infographie
Chiffres /Inégalités des richesses : l’infographie Réflexion /Tout ce qu'il faut savoir sur les derniers prix Nobel
Réflexion /Tout ce qu'il faut savoir sur les derniers prix Nobel